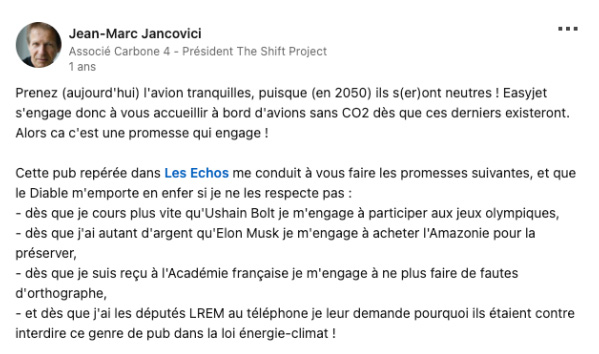Le terme greenwashing est une contraction des mots “green” (vert) et “whitewashing” (blanchir) et trouve son origine dans un article de 1991. En français, le terme est généralement traduit en “écoblanchiment” et parfois en “verdissage” ou “verdissement” même s’il ne doit pas être confondu avec le marketing vert
Notons que, dans le cas du greenwashing, les dépenses engagées par l’entreprise pour verdir son image sont bien souvent supérieures aux dépenses allouées au développement durable et à l’environnement, constituant l’un des premiers signaux d’alerte.
Toutefois, le greenwashing peut demeurer difficile à détecter car il sait s’adapter aux préoccupations de la société civile. C’est notamment le cas des très populaires et mensongères compensation carbone et reforestation, largement mobilisées par les marques pour ne pas remettre en question leurs modèles de production et l’impact de leurs activités. On citera également certains écolabels créés de toute pièce par les marques, sans vérification par un organisme indépendant.
En plus de souvent flirter avec l’illégalité, le greenwashing a donc de sérieux impacts puisqu’il ralentit la transition écologique en freinant l’innovation et écorche la confiance des consommateurs. Il entretient par ailleurs la confusion sur les efforts réels à mettre en œuvre et sape le travail de sensibilisation réalisé par la communauté scientifique ainsi que les associations.
Pour terminer, précisons que tous les cas de greenwashing ne sont pas nécessairement volontaires mais résultent plutôt d’une méconnaissance du cadre déontologique de la communication environnementale. Il faut bien un peu de (presque) positif non ?